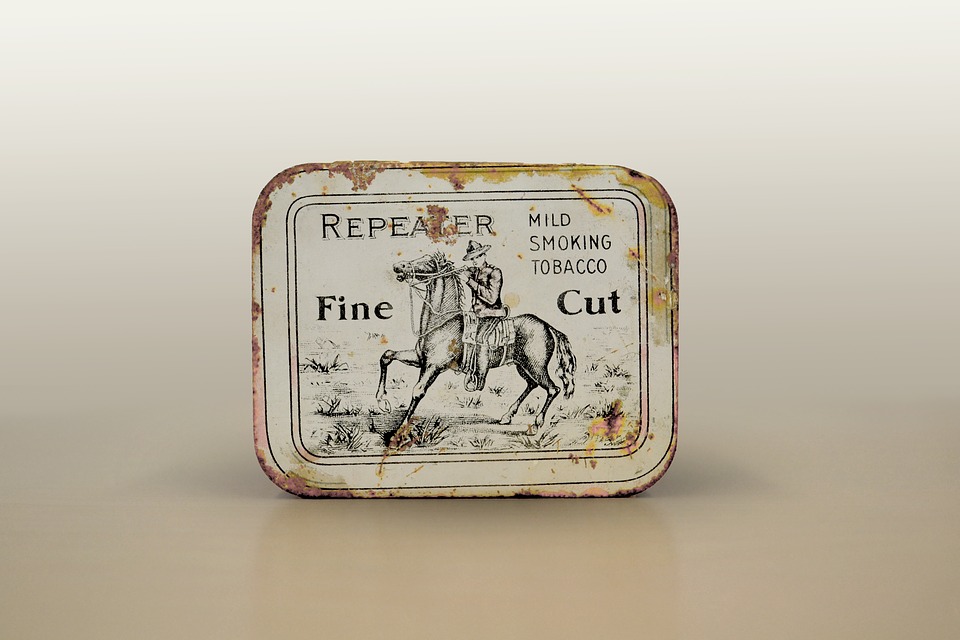L’ouvrage d’Emile H. Malet n’est pas une biographie de Freud. Il en existe plusieurs, de grande qualité. Il n’est pas plus une étude sur tel ou tel concept ou aspect de la pensée freudienne. Il ne se propose pas d’éclairer ou d’étudier ce qu’était, pour Freud, le judaïsme en créant un écart, une distance, entre l’inventeur de la psychanalyse et un objet d’étude, assurément singulier, mais néanmoins réductible à tant d’autres. La judaïté ne s’entend ici ni au sens d’une religion ni au seul sens d’une tradition. Elle se définit par l’appartenance à un peuple et au sentiment d’identité qui en découle.
Moins qu’une étude sur l’identité juive, en l’occurrence jamais récusée, Emile H. Malet confronte le lecteur aux affirmations par Freud de son identité. Affirmation aussi incontestablement franche que singulière et, à ce titre, paradoxale. L’homme juif, c’est Freud. Mais quel juif était-il ? Que disait-il de lui, de l’homme qu’il fut en le disant, et que dit-il du juif en le disant ? C’est la force, et le paradoxe, de cet ouvrage de présenter et soutenir cette question d’identité en la divisant ainsi. Mais, à le lire, le lecteur sera convaincu que cette division et ce paradoxe reconnus et, en un autre sens récusés, sont ceux mêmes de Freud. En 1926, George Sylvester Vierek, journaliste américain d’origine allemande, interroge Freud sur la montée de l’antisémitisme. Il lui répond clairement : « Je me suis considéré comme un Allemand intellectuellement, et puis j’ai pris conscience des préjugés antisémites, en Allemagne et en Autriche. Depuis ce temps, je ne me considère plus comme allemand. Je préfère dire que je suis juif. » Dans une lettre à Sabina Spielrein, il est encore plus affirmatif : « Pour ma part, comme vous le savez, je suis guéri de toute séquelle de prédilection pour les aryens et je veux supposer, si votre enfant est un garçon, qu’il deviendra un inébranlable sioniste […]. Nous sommes et nous restons juifs. »
Freud fut un humaniste et un homme des Lumières et de la raison. Un savant, un homme de science, qui voulut faire de la psychanalyse une conquête libératrice au service d’une croyance en un progrès émancipateur. Nul doute que sans sa formation, sans son désir d’appartenir à une communauté scientifique et humaine, il n’aurait pas accompli son œuvre. Il n’aurait pas plus supporté la solitude, l’échec et parfois le rejet s’il n’avait pas eu le sentiment d’être un pionner et un précurseur. Il se représentait ainsi son destin : « La science ne ferait nullement attention à moi de mon vivant. »
Dans ce mouvement de fondation, d’autoanalyse et de multiples découvertes, aux conséquences cliniques et anthropologiques, il s’éloigne des illusions, croyances et fantasmes de son enfance. Comment imaginer que le chemin qui le conduit de la découverte du complexe d’Œdipe à l’écriture de Moïse et le monothéisme n’ait pas profondément modifié son propre rapport à la tradition et, comme il l’écrit, « à la religion de ses pères » ?
Comment, « quand on fait soi-même partie du peuple en question », « signifier à un peuple que ne relève pas de son identité l’homme qu’il célèbre comme le plus grand de tous ses fils » ! Le projet du Moïse fut entrepris en 1934. Rien, ni l’exil ni l’approche de la guerre n’empêcheront Freud de publier en 1939 les trois essais qui le composent. On peut y voir, au contraire, une ultime décision, une fidélité à ses œuvres, une inscription dans l’histoire du peuple juif de l’hypothèse historique du meurtre du fondateur. « L’homme Moïse » interroge-t-il l’« homme juif » qu’il fut ?
Dans la préface rédigée en 1930 pour la traduction en hébreu de Totem et Tabou, il tient à s’en expliquer. « L’auteur, précise-t-il, qui ne comprend pas la langue sacrée, est devenu totalement étranger à la religion de ses pères […] sans avoir pourtant renié son appartenance à son peuple. » Il ressent cependant « sa spécificité comme juive et ne la souhaite pas autre ». Imaginant la surprise du lecteur, il répond à l’objection : « Si on lui demandait : qu’y a-t-il encore de juif en toi, alors que tu as renoncé à tout ce patrimoine, il répondrait : Encore beaucoup de choses, probablement l’essentiel ! »
Force et paradoxe de cet essentiel, lui qui a « renoncé » à ce patrimoine écrit à son fils Ernst : « C’est quelque chose d’authentiquement juif que de ne renoncer à rien et de suppléer à ce qui a été perdu. »
Quel est cet essentiel, cette « claire conscience d’une identité intérieure » pour cet « incroyant », « élevé sans religion mais non sans le respect de ce que l’on appelle les exigences éthiques de la civilisation humaine » ? Un essentiel dont la force ne fait pour lui aucun doute, mais « qu’il serait toutefois incapable de formuler en termes clairs ».
Emile H. Malet amène le lecteur, à travers une longue et précise enquête, au cœur de cet essentiel où Freud avec son génie a puisé la force de construire son œuvre. Un essentiel que l’on retrouve dans la psychanalyse et qui fait de celle-ci une œuvre civilisatrice.
Emmanuel Levinas pensait que « le Juif est l’entrée même de l’événement religieux dans le monde : mieux encore, il est l’impossibilité d’un monde sans religion ». Freud, ce juif sans religion, « incroyant », comme il l’écrivait, donne une autre réponse. L’homme ne peut vivre sans père, sans la question du père, car il ne peut oublier qu’il est un fils. Freud opère ce déplacement du religieux à la question du père et de celle-ci à celle du fils. Comment être fils sans la religion du père, telle serait le sens, et l’énigme, de la démarche freudienne.
Loin que la psychanalyse résolve ces questions (qu’est-ce qu’un père ?, qu’est-ce qu’un fils ? qu’est-ce qu’une fille ?), elle les ramène à l’essentiel. Un essentiel qui, pour Freud, est aussi celle de l’homme juif qu’il est et était.
Patrick Guyomard
Freud, et l’homme juif, Emile H. Malet, préface d’Avraham B. Yehoshua, Paris, CampagnePremière/, 2016.