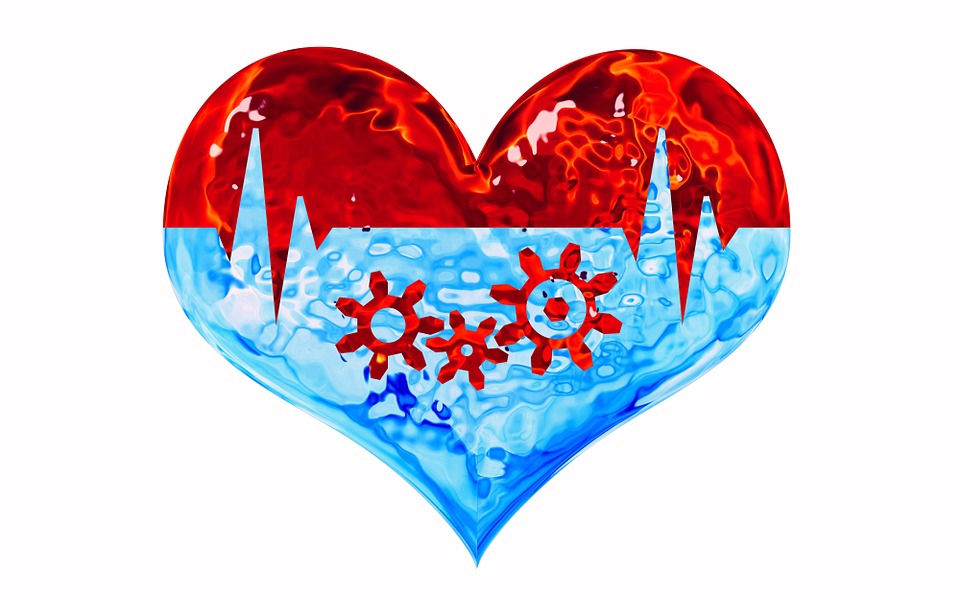Dialogue sur le transhumanisme entre Jacques Rouessé, Professeur de médecine, Académie de médecine, et Sarah Carvallo, Philosophe. ECL-UMR 5037, 4 février 2016
Q/R : La médecine : une promesse ?
Dans votre question, le terme de promesse est remarquable. Pour en saisir le sens, il faut accepter de reprendre l’histoire de la médecine sur une temporalité longue.
La médecine ancienne ne se constitue pas comme promesse : elle se détermine d’abord comme une théorie, la science du vivant. Dans ce projet, elle vise à établir la connaissance de la santé ; la pathologie et la thérapeutique s’avèrent secondaires. Qu’est-ce qu’un corps sain ? C’est une question à la fois philosophique et scientifique, qui suppose la nature humaine comme réalité parfaite. L’enjeu thérapeutique n’arrive qu’après avoir répondu à la question du corps naturel et requiert d’être fondé sur un savoir vrai. Par conséquent, le médecin antique – Alcméon, Hippocrate, Aristote, Galien ou Rufus – cherche à connaître la santé, qu’il détermine comme équilibre (isonomie) entre les éléments. Il compare souvent la santé à la beauté : la santé est une juste proportion entre le chaud, le froid, le sec et l’humide ; la beauté, une juste proportion entre les parties, qu’on peut mesurer de façon quasi mathématique comme dans la statue du Canon de Polyclète.
Ainsi la médecine antique vise d’abord l’équilibre. Elle bannit tout excès, toute idée d’amélioration, parce que justement le corps humain est beau et sain par nature. Tout le reste n’est qu’accident, contingence, pathologie. Cette conception traduit une conviction profonde de la culture grecque, qui s’exprime à travers l’adage « rien de trop » (mêdén àgan). Il résume à la fois la sagesse, l’esthétique et la médecine grecques.
La médecine moderne introduit une rupture, puisqu’elle se constitue désormais comme promesse d’une vie plus longue, plus saine, plus heureuse. Ce qui a rendu cette césure possible, c’est l’introduction de l’infini en mathématique, en astronomie, en anthropologie. L’infinitésimal et l’infiniment grand ouvrent de nouvelles logiques, qu’exprime la devise moderne : « plus ultra », toujours plus loin. D’un point de vue anthropologique, cette injonction moderne traduit l’idée de perfectibilité au cœur de l’humanisme. Être de liberté, l’homme s’avère capable d’un savoir désintéressé sur le monde, qui lui permet d’exercer sa raison à la fois en sciences, dans les techniques, en politique et en morale : cet usage de la raison le voue à devenir comme maître et possesseur de la nature, l’émancipe des croyances obscurantistes, et rend possible un contrat social qui fait advenir chaque citoyen à la majorité d’homme libre. Dans cette dynamique, le médecin ne se contente plus de guérir, mais d’améliorer. Ainsi émerge déjà le projet, voire l’obligation, de retarder la vieillesse. Bacon et Descartes partagent cette injonction, qui justifie un nouveau recours à la technique – en l’occurrence, la fabrication de remèdes.
« Les poils blancs qui se hâtent de me venir m’avertissent que je ne dois plus étudier à autre chose qu’aux moyens de les retarder. C’est maintenant à quoi je m’occupe, & je tâche à suppléer par industrie (…). Si nous nous gardions seulement de certaines fautes que nous avons coutume de commettre au régime de notre vie, nous pourrions sans autre intervention parvenir à une vieillesse beaucoup plus longue et plus heureuse que nous ne faisons[1]. »
« On se pourrait exempter d’une infinité de maladies, tant du corps que de l’esprit, & même aussi peut-être de l’affaiblissement de la vieillesse, si on avait assez de connaissance de leurs causes, & de tous les remèdes dont la Nature nous a pourvus[2]. »
La connaissance n’est plus un but en soi, mais un moyen pour améliorer nos existences. A la vérité se substitue l’utilité. De fait, à l’époque émergent de nouveaux remèdes, la plupart importés d’Amérique ; la chimie procure de nouvelles méthodes de purification et transformation des substances pharmaceutiques. La querelle de l’Antimoine à la Faculté de Paris (1564-1666) révèle l’acuité des débats sur le pharmakon, le point critique pour distinguer le remède du poison. De nouvelles pratiques se structurent, notamment les premières infusions veineuses, puis transfusions sanguines (de l’animal vers l’homme), dont certaines semblent assez bien réussir… au moins dans les premiers jours (entre 1657 et 1670, date où le Parlement français l’interdit). Il faut souligner néanmoins qu’à l’époque cette interprétation héroïque de la médecine n’a encore rien d’évident. Elle demeure le fait d’individus et n’est pas relayée par l’Université. Les médecins de la Faculté de Paris comme Riolan sont très méfiants ; plutôt conservateurs, ils se considèrent comme les gardiens de la tradition et cherchent à maintenir la conception antique. Par ailleurs, la théorie et les pratiques médicales sont très hétérogènes à l’époque : les facultés d’Oxford, Londres, Montpellier, Padoue, Paris, Leyde, Halle enseignent chacune une théorie et des pratiques différentes. Chacune essaie de conserver son monopole régional. Il faut attendre la fin du dix-huitième siècle pour que la médecine s’unifie en France ; mais c’est surtout le développement de la médecine expérimentale dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, qui promeut la figure prométhéenne de la médecine.
Effectivement, nous en sommes aujourd’hui les héritiers. Le transhumanisme reprend et transforme l’idéal humaniste en introduisant une rupture fondamentale, puisqu’il requiert en fait l’émancipation de notre condition humaine biologique. Les nouvelles connaissances – notamment, la génétique depuis 1953 –, les nouvelles technologies – séquençage, screening, informatique, pharmaceutique – et les progrès de la chirurgie liés entre autres au perfectionnement de l’immunologie, offrent de nouvelles potentialités pour transformer notre corps. La devise de notre époque serait sans doute « better than well ». Nous ne nous contentons plus d’être en bonne santé ou normaux, mais nous visons une amélioration continue de nos capacités psychologiques, physiologiques, mentales.
J’interprète cette nouvelle quête du perfectionnement à partir d’une rupture épistémique. Dans l’Antiquité, le corps humain est parfait par nature : la médecine vise à en préserver l’intégrité, elle est au service de la nature. Cette perfection désigne une idée régulatrice de la médecine. Aujourd’hui, nous avons une approche statistique de la santé. Et nous savons que les moyennes et médianes peuvent évoluer. Ainsi nous devons réactualiser les référentiels concernant la taille, les pathocénoses ou modifier la longévité : devenir plus grands, avoir telle ou telle maladie, vivre plus longtemps, obtenir de meilleures performances, signifie qu’une majorité d’entre nous grandissons plus et vieillissons mieux, que nos pathologies évoluent. Cette norme statistique descriptive devient alors une norme prescriptive. Elle crée une attente de la part de la société et une demande de la part des individus plus petits, moins performants… Il suffit alors de changer le curseur et de prendre la partie droite de la courbe de Gauss pour se donner de nouveaux objectifs ; puisque c’est possible, c’est normal, il faut le faire. Et de fait, nous avons les moyens techniques, pharmaceutiques, sociaux, pour faire évoluer nos moyennes – au passage, sans que cela ne résolve les difficultés des personnes différentes. La médecine promet déjà de vieillir mieux, de grandir plus, d’être plus performant, et cette promesse est performative, autrement dit elle a des effets réels – notamment à travers les investissements et les grands projets scientifiques ou industriels – parce que nous investissons énormément de moyens et d’espoirs en cette promesse… peut-être pour éviter de regarder la vérité d’une existence humaine, qui ne se mesure pas en termes de performance ou d’années.
Où est la cause ? Où est la conséquence ? En tout cas, l’évolution de la médecine va de pair avec une transformation profonde de notre rapport à la nature, de notre conception de l’homme.
Q/R : L’immortalité : vieux rêve et nouvelle réalité
Dans l’Antiquité, l’immortalité concerne uniquement la gloire qu’un homme peut acquérir à travers une vie exemplaire, certainement pas la perpétuation physiologique de l’existence. Les Grecs distinguent la vie-bios que l’on raconte dans les biographies et qui doit être digne d’admiration, et la vie-zoé, qui concerne les organes et ne possède aucun intérêt en soi. Ainsi Achille choisit une vie héroïque et brève comme condition du kleos, la permanence de sa mémoire glorieuse parmi les hommes. La possibilité de l’immortalité physiologique n’est envisagée qu’à partir du dix-septième siècle. Francis Bacon vaut comme marqueur de ce nouvel horizon. Dans son Historia vitæ et mortis (1623), Bacon veut comprendre comment les hommes pourraient retrouver une vie aussi longue qu’Adam (930 ans) ou que les Patriarches (969 ans pour Mathusalem). Comme tous les hommes de son époque, Bacon considère ces chiffres donnés dans la Bible comme des faits bien établis. Selon lui, ils signifient que la vie est comme « le feu des Vestales, potentiellement éternel ». Or après le Déluge, la longévité se réduit à 80 ans. L’intuition baconienne consiste alors à orienter le savoir non plus vers la seule vérité, mais aussi vers l’utilité. Dans cette perspective, le recul de la vieillesse incarne un projet rationnel et réaliste.
Aujourd’hui, l’immortalité promise relève de plusieurs régimes. Premièrement, un énorme marché pharmaceutique et paramédical (par exemple, avec des logiciels informatiques pour entretenir les capacités cérébrales) propose de ralentir ou repousser le vieillissement : le but n’est pas alors l’immortalité stricto sensu, mais l’éradication des pathologies associées à la vieillesse pour vieillir à la fois bien et longtemps. Ces offres présupposent que la vieillesse équivaut à une pathologie qu’il faut soigner. C’est un point débattu en médecine : certains estiment que la vieillesse est normale et peut ne pas s’accompagner de pathologies, d’autres qu’elle induit des pathologies inéluctables. Deuxièmement, l’immortalité concerne la permanence de l’individu : la cryogénie permet de conserver l’individu toute la durée nécessaire au perfectionnement technique, qui parviendra à trouver un remède contre le vieillissement. Il y a déjà un marché où des entreprises privées proposent ce service. Troisièmement, l’immortalité concerne la conservation du patrimoine génétique. Des banques de sperme et d’ovocytes ont été créées pour conserver l’identité génétique d’un individu afin de la transmettre par la suite, ou de faire des croisements à partir d’hommes ou de femmes remarquables, par exemple distingués par le prix Nobel. Quatrièmement, certains transhumanistes préconisent d’accéder à l’immortalité par l’intelligence artificielle. A la différence des autres voies pour l’immortalité, cette piste cherche à perfectionner le logiciel (software), plutôt que le matériel (hardware). Le transfert des données corticales dans du silicone permettrait de conserver le cœur de notre identité, c’est-à-dire notre intelligence. Il ne s’agit donc pas d’optimiser nos capacités biologiques, mais les potentialités non biologiques du cerveau. Celles-ci pourraient même croître de façon exponentielle en fusionnant plusieurs stocks de données cérébrales dans des logiciels superpuissants. En 2009, Raymond Kurzweil publie Transcend : Nine Steps To Living Well Forever, qui regroupe des conseils diététiques, comportementaux et considère le progrès informatique comme la voie vers l’immortalité. L’université Singularity de Google explore justement cette piste : en reprenant la loi de Moore qui préconise un accroissement exponentiel des découvertes grâce à la miniaturisation des processeurs informatiques, Kurzweil prédit l’occurrence d’un point de singularité, où nos capacités de calcul franchiront un seuil qualitatif nous permettant effectivement de réaliser concrètement les conditions logicielles de notre immortalité. Une fois ce point de basculement dépassé, la révolution biotechnologique permettra de reprogrammer notre héritage biologique, puis les nanotechnologies nous aideront à reconstruire de fond en comble nos corps.
A mon avis, tous ces projets d’immortalité sont utopiques et dangereux. Michael Sandel parle même d’infantilisme : nous voudrions que les technologies résolvent nos problèmes philosophiques, existentiels, médicaux, sociaux ou affectifs. Or ce qui compte dans une vie n’est pas la durée, ni même la santé, mais l’amour que chacun peut donner et recevoir. L’amour ne se mesure pas. Ce qui sauve une vie, c’est d’aimer et être aimé. C’est de trouver un sens à notre existence contingente et fragile.
Les Big Data et les individus
Les ingénieurs de la Google University, dont Kurzweil, ou Peter Thiel fondateur de PayPal et transhumanistes pensent que les Big Data peuvent vraiment nous faire accéder à l’immortalité. Bien évidemment, ils ne préconisent pas cet accès pour tous, mais seulement pour une élite à la fois fortunée et intelligente. Le transhumanisme suppose une politique libertarienne, qui accroîtrait substantiellement les inégalités, quitte à faire exploser les principes mêmes de la démocratie. En tout cas, il est incompatible avec l’idée d’égalité entre les hommes. En 2004, Fukuyama considère le transhumanisme comme le risque majeur.
Mais le transhumanisme ne remet pas seulement en question l’égalité des individus, il bouleverse le critère même de notre identité personnelle. Traditionnellement, nous cherchons à exister en tant que personne singulière. Plusieurs critères d’identité sont proposés pour attester que je demeure moi au cours de la durée : le corps, la mémoire, la conscience, la capacité de synthèse des représentations, la capacité de parole, la reconnaissance par autrui de mon identité… Dans le cas du transhumanisme, l’identité se réduit à un agrégat de données, qui ne garantissent pas une unité : on peut fusionner d’autres données, elles peuvent évoluer, je ne sais pas qui manipulera les logiciels ni sous quelle règle. Donc effectivement, c’est peut-être là le plus grand danger : se perdre soi, sous prétexte de durer plus longtemps et d’accroître nos capacités intellectuelles.
Drogue
La drogue ne désigne pas seulement une substance blanche. On peut être drogué de musique, de politique, de sexe, de jeux… La drogue caractérise une dépendance, qui empêche de vouloir et pouvoir se détacher de la consommation d’un bien ou service. Avant même d’induire une dépendance vis-à-vis des médicaments ou chirurgies, l’injonction du « Better than well » fonctionne déjà comme une drogue en ce qu’elle insinue en nous le désir de ne jamais se satisfaire de la réalité pour toujours chercher plus ou mieux à travers les biotechnologies. Effectivement, l’usage de compléments alimentaires, de chirurgie amélioratrice, de médicaments dopants induit des servitudes.
Mais pour le moment, le transhumanisme est surtout une idolâtrie, idolâtrie de soi, idolâtrie de l’homme à partir de ses capacités intellectuelles ou physiologiques purement individuelles. C’est notre veau d’or. D’autres époques eurent l’eugénisme philanthropique de Galton, l’homme total du communisme. Nous n’avons plus de grandes idéologies ; nous cherchons désespérément à redonner sens à nos capacités technoscientifiques et à l’argent inouï accumulé par des grands groupes comme Google. A partir d’un certain seuil, soit c’est absurde, soit il faut trouver de nouvelles raisons d’aller toujours plus loin avec toujours plus d’argent. D’ailleurs, Ray Kurzweil prend volontiers la figure d’un gourou.
Sur le fond, le transhumanisme repose sur une erreur fondamentale, qui consiste à croire que nous pourrions optimiser notre santé. Or la santé n’est pas un bien quantifiable. Soit on est en bonne santé, soit on ne l’est pas. Plus de santé ne signifie pas qu’on va mieux, mais qu’on sort de l’état de santé.
Q/R : L’homme chief manager de l’évolution grâce aux technosciences
Nietzsche faisait l’éloge d’un surhomme, Marx et les communistes d’un homme total, les transhumanistes d’un supersapiens. Il ne faut pas oublier que le transhumanisme émerge en 1957 sous la plume de Julian Huxley (New bottles for new wines) un peu après la seconde guerre, en pleine guerre froide, et juste après la découverte de l’ADN en 1953. Les fondateurs du transhumanisme Huxley ou Max More (More, True transhumanism, The Global Spiral) estiment qu’il est temps que l’homme prenne en main l’évolution. L’évolution et la sélection naturelle sont présentées comme des vérités scientifiques. Désormais l’homme a les moyens de devenir chief manager du processus. On retrouve dans le transhumanisme les grandes composantes des fausses religions du vingtième siècle : la volonté d’une assise scientifique pour garantir sa vérité, la projection dans un horizon qui semble à portée de main, une valeur morale présentée comme évidente et incontestable. Bref, un plan du salut où l’homme décide de se sauver tout seul avec ses propres moyens et en fonction des objectifs qu’il s’assigne.
[1]Descartes, Lettre à Huygens, 5 octobre 1637, AT I, p. 645. Repris dans la Description du corps humain, AT XI, 224.
[2] Descartes, Discours de la méthode, AT VI, p. 62.