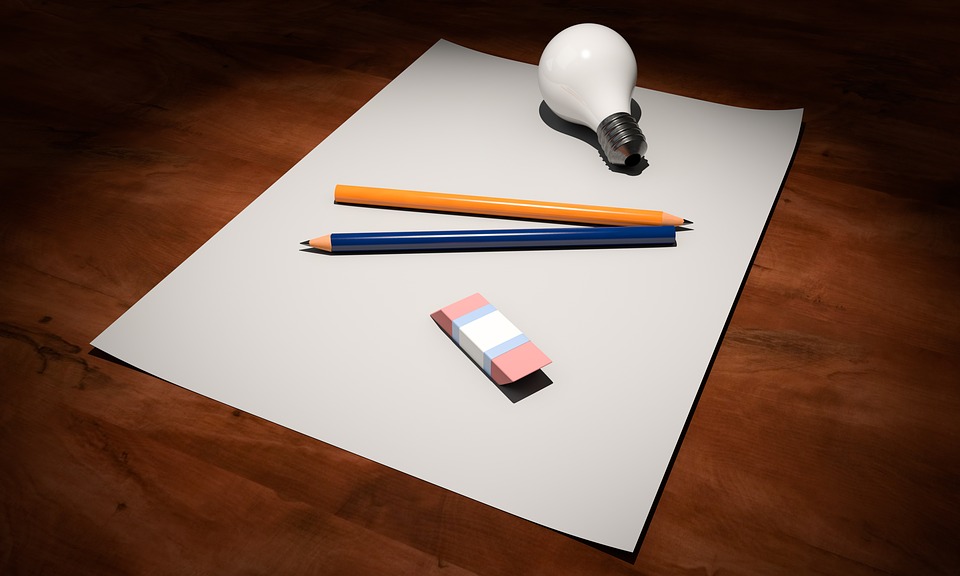Passages a fait un choix judicieux en axant ce colloque sur deux thèmes d’actualité fondamentaux : les réseaux, d’une part, et les relations France-Allemagne-Benelux avec la toile de fond européenne, d’autre part. Cela dit, le premier point qui m’a frappé, c’est que nous avons beaucoup parlé d’énergies intermittentes, d’énergies nouvelles, sans jamais remettre en cause le principe du développement de ces énergies au niveau de la génération. Reportons-nous dix ans en arrière ; on aurait dit : « Tout cela, c’est du gaspillage ; le soufflé va retomber ; ça ne va pas durer. » Mais aujourd’hui les énergies renouvelables, intermittentes sont installées. Les investissements mondiaux ont repris en 2014 ; ils ont représenté 280 milliards de dollars dans le monde, soit plus que dans les domaines conventionnels. Donc, c’est un fait acquis.
Mais le problème s’est décalé de la génération vers les réseaux. Ce n’était pas prévu car, dans la vision initiale, les énergies décentralisées étaient censées permettre des économies de réseaux. Pas de chance ! Ces énergies intermittentes ne dispensent pas d’avoir des réseaux pour l’appoint et pour le secours. Et il y a des raisons techniques plus sophistiquées sur l’inertie des réseaux, l’absence de machines tournantes, etc. Le besoin de réseaux devient donc majeur. On voit là apparaître un problème. Bien sûr, l’énergie intermittente s’est concrétisée dans les faits mais, en France, en Allemagne, en Europe, nous sommes allés trop vite et trop loin, au point de mettre immédiatement sous cocon des centrales conventionnelles qui venaient tout juste d’être inaugurées. On a dépensé trop ; l’Allemagne peut se le permettre car elle a des euros à recycler ; pour nous, c’est moins évident. La question qui se pose donc aux décideurs, c’est de savoir si, dans l’enthousiasme actuel vis-à-vis des réseaux, on ne va pas se mettre à nouveau à en faire trop. On connaît le problème des 4 000 kilomètres de lignes à haute tension reliant l’Allemagne du Nord à celle du Sud mais en France la note est également sévère.
Il faut savoir jusqu’où aller, ce qui pose plusieurs questions. D’abord, que faut-il faire prioritairement ? Il y a un problème technologique ; j’ai personnellement la conviction que le grand défi des cinq à dix prochaines années, c’est le stockage. Tous les intervenants du colloque n’étaient pas sur cette ligne de pensée. Mais j’ai l’impression que nous sommes au début d’une révolution majeure du type photovoltaïque et écrans plats. Aujourd’hui, du fait des progrès réalisés sur les batteries lithium ion pour véhicules électriques, du fait de la capacité de production excédentaire répartie entre quelque 14 producteurs mondiaux, les prix ont commencé à baisser et cette tendance va se poursuivre. Un article tout récent de McKinsey explique que, d’ici à 2020, le prix du kWh de capacité stockée passerait de 350 $ à 150 $. Je crois à cette perspective, mais il y a aussi d’autres voies et d’autres filières, comme l’aluminium ion, qui s’annoncent très intéressantes mais qui impliqueront des dépenses de R&D supplémentaires. Rappelons que, quand on stocke dans une voiture, il y a des problèmes de poids et d’encombrement. Si, en revanche, on fait du stockage dans un bâtiment, dans un centre commercial, ces problèmes disparaissent. Il y a donc d’autres solutions concernant le stockage : c’est un des rares points de convergence entre le gaz et l’électricité (car par ailleurs la distribution de ces deux matières interfère peu l’une avec l’autre), auxquels on pourrait ajouter l’hydrogène qui peut être intéressant comme solution de range extender pour les véhicules électriques.
Supposons qu’on ait défini ce qu’il fallait faire. On arrive aux grands problèmes organisationnels : qui décide ? qui paie ? qui gère ? On a dit que tout irait mieux s’il y avait un prix du carbone significatif ; c’est vrai, mais, sur ce point, les perspectives offertes par la COP21 ne sont pas très enthousiasmantes. Sur les questions organisationnelles, deux modèles se côtoient. En Allemagne, il y a 888 distributeurs qui font de la péréquation tarifaire à l’intérieur de leur domaine ; ce sont des « petites péréquations locales » qui n’ont rien à voir avec la péréquation nationale que nous pratiquons en France avec ERDF. Le coût des réseaux, pour un ménage allemand, varie ainsi plus que du simple au double (de 4,2 à 8,88 centimes par kWh) selon les distributeurs. Chez nous, nous sommes plutôt aux environs de 3,5 centimes, donc bien placés au plan économique. Mais le modèle français est hérité du passé ; il est efficace mais il est attaqué de toutes parts. Bien sûr, on réaffirme à l’envi le rôle de service public d’ERDF, on fait des grandes déclarations de principe mais, dans les faits, la loi donne progressivement de plus en plus de pouvoir aux autorités organisatrices dans le domaine de l’énergie (collectivités locales et leurs émanations) : chaleur, économies d’énergie, véhicules électriques, smart grids, prises de participation directes, organisation de territoires à énergie positive. Jusqu’où irons-nous dans ce changement progressif de modèle ? La péréquation peut-elle résister à une telle évolution et d’ailleurs est-ce souhaitable ? Si on promet à des collectivités locales de répartir sur l’ensemble des autres collectivités, grâce à la péréquation, les dépenses qu’elles engageront pour constituer des territoires à énergie positive ou pour développer toute autre action de caractère local, il y aura vite un problème. On pourrait aussi s’interroger sur la mission fondamentale d’ERDF qui risque de se transformer en une société de moyens agissant pour le compte d’un certain nombre de collectivités concédantes qui auront le pouvoir de décision. Ce sont des sujets majeurs qui ne doivent pas être traités dans l’urgence mais qui nécessiteront d’être approfondis dans les mois et les années qui viennent.
Je vais terminer par une remarque. On a beaucoup parlé de big data sans savoir très bien ce que ça recouvre. Mais je rappelle quand même qu’on ne se chauffe pas, qu’on ne s’éclaire pas avec des bits d’information ; il faut aussi des électrons pour l’électricité ou des molécules pour le gaz. Or le réseau, même celui géré par ERDF, est vulnérable ; il suffit de regarder les résultats des tempêtes récentes. En 1999, Lothar et Martin, en quelques heures, ont mis hors service 2 500 000 usagers. En 2009, la tempête Klaus dans le Sud-Ouest a touché pendant dix jours 1 750 000 usagers Il n’y a pas que les big data ; il faut penser aussi au hard.
Note postérieure au colloque : Quelques jours après le colloque, les effets de la canicule venaient confirmer la fragilité du réseau dans certaines régions (notamment en Bretagne).
Jean-Pierre Hauet,
ancien Chief Technology Officer d’Alstom